La haie, tout le monde en parle. Tout le monde loue ses vertus écologiques, l’ombre qu’elle fait au bétail, aux vaches, surtout, l’écran qu’elle est face aux vents, les paysages qu’elle fabrique. Quelques politiques et la plupart des chercheurs, naturalistes et chasseurs de ce pays la promeuvent, déplorant qu’on l’ait tant détruite. Mais comment a-t-on pu la détruire ? Qui est-ce « on » ? Dans notre culture collective, ce sont les agriculteurs, coupables d’avoir osé – à la demande des pouvoirs publics – couper ce patrimoine durant le remembrement des années 1960-1980, et de le faire encore par facilité ou désintérêt. Coupables d’un crime, celui d’avoir rendu la France chauve, de l’avoir unifiée par la coupe rase de ses arbres paysans. Corridor sociologique autant qu’écologique selon le mot de Léo Magnin dans son livre La vie sociale des haies, paru chez Actes Sud, la haie est un fétiche sur lequel chacun projette ses fantasmes. En tant que telle, elle cristallise la confrontation habituelle, polarisée, entre des groupes sociaux. Selon le manichéisme qui sert lieu de débat en France, l’agriculteur y verrait un obstacle du passé tandis que l’urbain ou même le rural – après tout, les agriculteurs sont désormais minoritaires dans les espaces ruraux – la considère comme l’acteur indispensable de la beauté de leurs paysages. Cliché contre cliché. Chacun voit l’autre dans la haie, et la haie en subit les conséquences : elle n’avance pas ! On a beau en planter, elle continue de reculer. Votée le 30 janvier 2005 par le Sénat, la proposition de loi « en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie » a pour ambition d’ajouter réellement 50 000 kilomètres de haies au linéaire actuel d’ici le 1er janvier 2030. Lequel se monte à 750 000 km, contre 2 millions au début du XXe siècle. Comment faire ? L’Ademe, la DRAAF, la Région de Bourgogne-Franche-Comté ont en partenariat avec Alterre et le réseau haies (ex-Afac agroforesteries, un des rares lobbys de la haie) cherché des réponses en interrogeant les professionnels qui font vivre la haie. Filière amont, filière aval, agriculteurs et techniciens, le monde de la haie s’est réuni à Dijon le 23 janvier 2025.
Photos et vidéo © FD
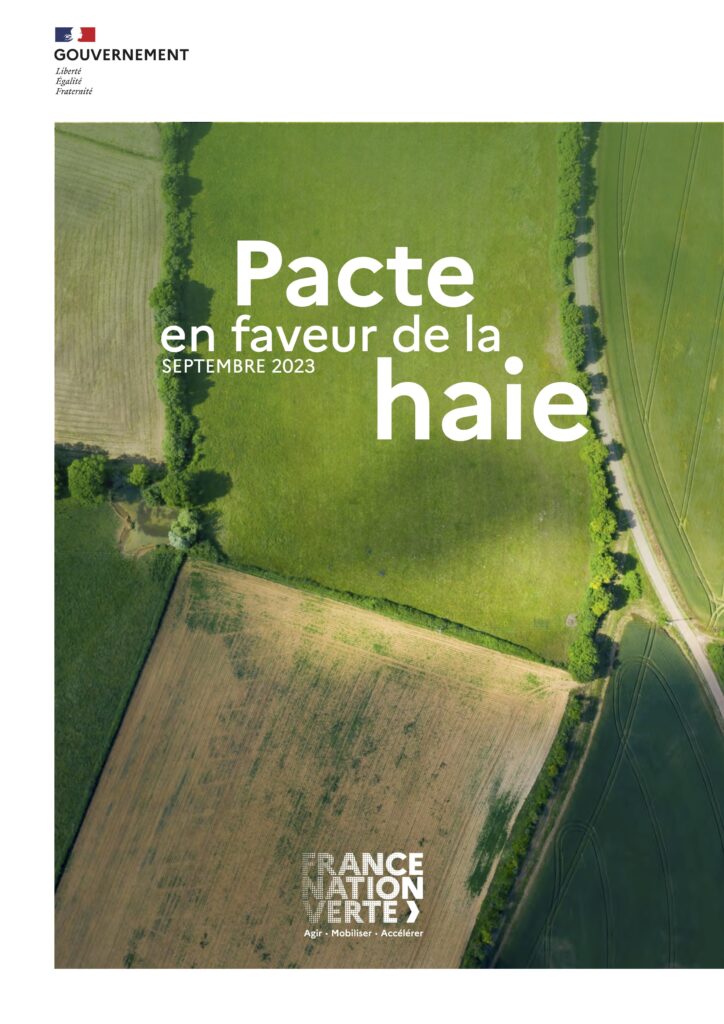
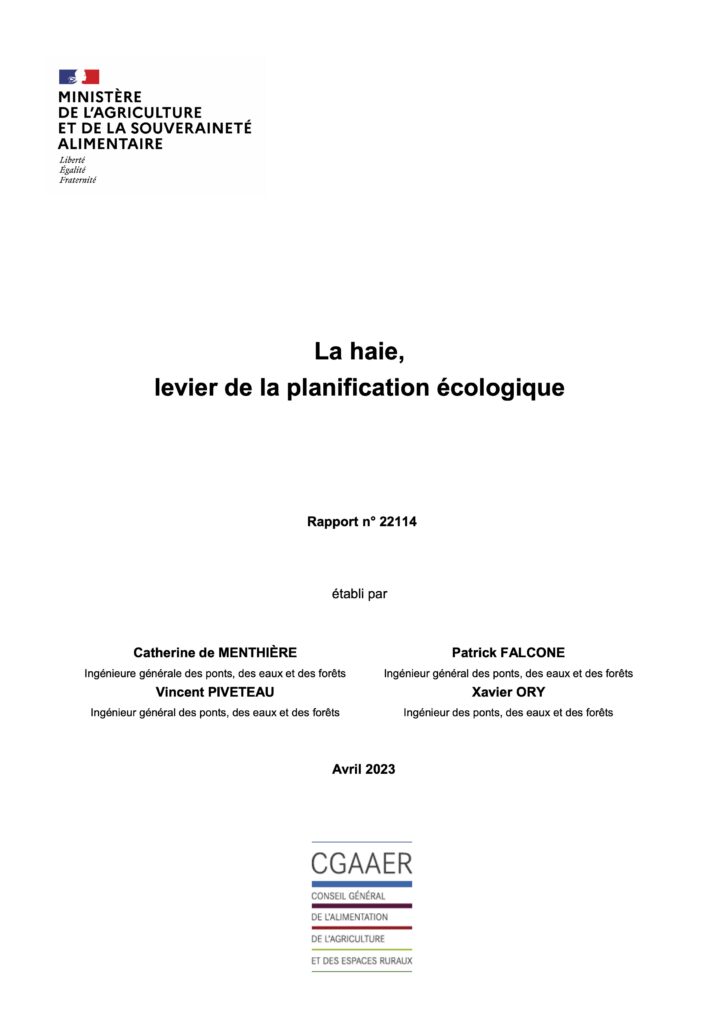
Une haie, une bande enherbée et des bénévoles
La haie c’est d’abord des graines, des plants et puis des plantations. Ce sont des métiers, des techniques, des savoir-faire, du temps et de l’argent. Installé à Sennecey-le-Grand, Maxime Lacroix produit en semis direct du colza, de l’orge, du blé, du sorgho, du soja et du maïs sur 250 ha, en fermage. La haie lui est venue à la fois d’une demande de ses propriétaires et de la nécessité de trouver une solution à deux problèmes récurrents : l’érosion du sol, et des attaques d’insectes parasites. « Ma motivation, c’est vraiment la biodiversité. Avoir des insectes, et des oiseaux qui mangent les pucerons, les cécidomyies, les cicadelles, les limaces et les petits rongeurs qui m’embêtent. » Quand il a pris ses terres [FD : c’est son vocabulaire, en itv], des haies avaient été arrachées par ses prédécesseurs. Il fallait en replanter, mais il allait lui en coûter autour de 50 000 euros, pour 3,8 km. La haie était du temps de sa gloire un atelier à part entière ou un appoint à tous les autres qui rapportait à l’exploitation, désormais elle est une « infrastructure écologique » qui coûte cher. « Sans le Plan de Relance, je n’aurais pas pu le faire. » Sans le bénévolat non plus : 2 km ont été plantés par des élèves du lycée agricole de Tournus. Des prunelliers, des érables, des charmes, des aubépines, introduits sur un seul rang, sur un sol que l’agriculteur avait en prévision préparé.
Plantée, la haie doit ensuite être entretenue. Un autre coût, qui oscille entre 300 et 450 euros HT par an et par kilomètre, selon le nombre de rangs et le matériel utilisé. Et là, il n’y a pas de discussion, « l’épareuse, ce n’est pas du boulot, ça abîme ! » Elle coupe mal en arrachant un peu, ouvrant les tiges aux attaques de parasites et aux maladies. Le lamier n’est pas mieux, il serait même pire. « Avec ma femme on fait de la taille douce, on coupe, net, ça prend du temps. » Dans un monde idéal, le paysan partirait chaque matin faire son tour de plaine avec un sécateur dans la poche. Il couperait un peu chaque jour, mais quoi, comment ? L’entretien de la haie s’apparente dans le geste à un travail de forestier, à tout le moins à celui d’un jardinier-paysagiste, pas à celui d’un agriculteur. Il s’agirait de le former. « Mais de toute façon, il n’y a plus assez de personnes dans les fermes… » déplore le cultivateur qui regrette qu’on ne pense pas la haie aussi pour son entretien futur : « on lui laisse quelques mètres de large, mais c’est une bande enherbée qu’il faut à ses pieds, large, afin que l’on puisse passer le tracteur pour venir l’entretenir correctement. Sinon, faute de place, on ne pourra faire passer que l’épareuse dans le champ. » La réglementation ne dit rien de précis, la haie doit faire dans les 1 mètre de large, avec un « ourlet » herbacé d’1 mètre. On est loin des 3 à 7 mètres qu’en général défendent les chercheurs. Maxime Lacroix en est à 5 mètres.

Partir des graines
Naturellement, on a envie de voir ce que l’on fait. si l’on plante une haie, on a envie que cela se remarque, et vite ! Alors il est tentant d’acheter des plants déjà hauts. Non, répondent les spécialistes : il faut des plants jeunes qui seront moins fragiles. Des plants locaux nés de graines locales, de la marque « Végétal local » (créée par l’OFB) que des pépiniéristes ont fait grandir. « C’est ce qu’on fait depuis 6 générations, 150 ans : on produit des jeunes plants forestiers et bocagers depuis… toujours, » présente Pierre-Henri Petit, responsable commercial des historiques pépinières Naudet. Qui font aussi dans le sapin de Noël, le reboisement et la compensation carbone. « On part toujours de la graine. Pour la forêt on l’achète aux deux fournisseurs autorisés par l’État, la sécherie de La Joux et Vilmorin. Pour le végétal local, pour la haie, on passe par des associations » qui font la récolte manuellement. Les promeneurs récupèrent des fruits, des baies, des drupes et des coques, qu’ils « dépulpent » afin de récupérer les graines. Un vrai métier : imaginez extraire les quatre pépins d’une pomme, à la main, sur des centaines de fruits ! La mécanisation est presque impossible eu égard à son coût. Il faut des mains. « Ensuite tous ces récolteurs nous livrent, et on regarde la qualité de la graine. Elle est très variable, elle va dépendre de la récolte, de l’hygrométrie, du conditionnement, et du hasard. » Le pépiniériste coupe quelques graines pour voir, il fait des tests de germination : ça pousse, et comment ? « On a des surprises chaque année. En 2023, les sureaux ont fait beaucoup de fruits, pourtant les graines avaient séché sur pied, à cause de la canicule. » Les aléas de la météo se lisent dans les graines. Difficulté supplémentaire pour les végétaux ligneux, la dormance hivernale, qui oblige à faire germer lentement les graines, à conduire les plants doucement du chaud des serres au temps qu’il fait dehors. « On appelle cela une stratification, pour la viorne par exemple la latence est de 24 mois. » Trois personnes formées par Naudet ne s’occupent que de la levée des graines.

Former une filière
Les chasseurs aiment la haie bocagère et sont parfois aussi des récolteurs pour les pépinières. La haie, c’est du gibier. [FD : il n’y a pas de guillemets, ce n’est donc pas ses propos, mais son style, et le mien : une haie bien vive, c’est une planque à gibier] Chargé de mission bocage à la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, Gaëtan Bergeron propose du clé en mains aux agriculteurs : « Selon les besoins de l’agriculteur, ses objectifs, on lui propose de tout prendre en charge, la séquence de plantation, l’organisation du chantier, la préparation du sol, le paillage, la protection des plants, tout cela avec les pépinières Naudet. » Coût moyen, entre 18 et 20 euros le mètre linéaire, hors taxes. Une fois plantée, bien entretenue, garantie des chevreuils – le coût du manchon de protection qui entoure le tronc du jeune plant est équivalent au coût de celui-ci ! la haie va produire du bois. Qui se doit de servir à quelque chose. À fabriquer de la plaquette par exemple. « On travaille là-dessus avec la coopérative Bourgogne du Sud depuis 2013. Notre but est de développer une filière commune, avec des approvisionnements de chaudières, dans un rayon de 50 km maximum, » histoire de ne pas grever les coûts de production du kWh par ceux du camion et par la même occasion ne pas risquer d’annuler la neutralité carbone du système par un transport sur une trop longue distance. Le bilan carbone et énergie de la filière bois-énergie a toujours été fragile. C’est la coopérative qui gère le transport du bois. « On alimente aujourd’hui 16 chaudières à bois collectives, en grande partie avec de la plaquette produite par déchiquetage de bois issu de haies. On complète avec du bois forestier quand il n’y en a pas assez. »
Cinq agriculteurs, des éleveurs et des producteurs de céréales, alimentent à eux seuls la filière. Ils sont assurés d’avoir les fonds pour entretenir leurs linéaires de haies. « Chacun a signé un Plan de Gestion Durable de la Haie (PGDH). C’est un peu compliqué [42 critères] et un peu cher, mais pour nous, cela nous permet de connaître précisément le linéaire de haies grâce à un inventaire, et à l’agriculteur d’avoir un plan de gestion sur 25 ans. » La mise en place d’un PGDH revient entre 1500 et 2500 euros HT (plus le coût annuel d’utilisation d’un programme informatique, 200 €/ferme par an et 50 €/utilisateur) ; de 30 à 70 % du montant pouvant être pris en charge par les collectivités, dont la Région Bourgogne-Franche-Comté (qui finance entre 50 % et 60% selon certains critères techniques). La part d’aides publiques peut grimper à 80 % dès lors qu’il y a un abondement complémentaire en plus des de certains département des aides la région). Et même… 100% avec le concours de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, via le Pacte en faveur de la Haie, si le projet représente un minimum de 3 000 euros HT. Alterre, l’agence de l’environnement de la région BFC est là pour aider les agriculteurs et les porteurs de projets à s’y retrouver parmi tous ces financeurs. Grâce à ces aides publiques, et si le paysan peut justifier d’au moins 6 % de haies sur sa surface agricole utile (SAU) – en gros, pour une SAU de 100 hectares, il faut un minimum de 3 kilomètres de haie – il peut toucher 7 euros par hectare de « bonus haie » dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Si, et seulement si son PGDH a été labellisé « Label Haie ». Lequel revient pour l’agriculteur à 350 € /an (100 € de redevance au Label Haie et 250 € de coût d’audit externe par CERTIS /an). Ces montants ne sont pas rien : il faut que la haie rapporte pour qu’elle en vaille le coup.

Se chauffer à la haie
Elle le vaut pour Christian Simonin, maire de Vendenesse-sur-Arnoux. « On a intégré la haie dans le cadre du plan d’alimentation territoriale (PAT) et dans notre Plan climat-air-énergie territorial PCAET, comme revenu complémentaire pour les agriculteurs. » Quentin Boyer, agriculteur et conseiller municipal de la commune, s’est donc engagé à la fournir en bois produit par la coupe de ses deux kilomètres de haies, des alignements d’arbres en bordure de la rivière Arroux. Sur place, les chênes sont élagués et les bois « blancs » typiques d’une ripisylve (aulnes, saules, frênes…) sont coupés, mais pas dessouchés, et sur un linéaire restreint. Partenaire de l’opération, la CUMA Compost 71 fournit le « grappin-coupeur » et la déchiqueteuse. D’un coût initial de 200 000 euros, la chaufferie bois existe depuis une dizaine d’années, une unité de stockage du bois déchiqueté est en projet. C’est un maillon important de la filière, car le séchage des plaquettes demande quatre mois, passés pour l’instant sur un terrain qui voisine le cimetière ; or nombre de dossiers de subventions exige une proximité entre stockage du combustible et lieux de combustion.
« On a commencé à se chauffer au bois bocager l’an dernier, en 2024. C’est très satisfaisant. Avec cet exemple, on fait en sorte de proposer une demande, pour que l’offre suive, localement. » Intéresser les agriculteurs pour qu’ils ne broient plus leurs coupes de haies, car la commune leur propose de les valoriser à condition que les haies aient été bien taillées. La déchiqueteuse passe chez eux, un camion se charge ensuite d’amener les plaquettes à la commune. « On achète à l’agriculteur au même tarif que le bois forestier, qui normalement vaut plus cher, c’est-à-dire 117 € HT la tonne. » Un prix a priori aussi attractif pour le paysan qu’il est intéressant pour la commune : par rapport à ce que lui coûtaient en fioul ses trois anciennes chaudières d’avant 2013, le budget énergie de la commune est passé de 13 000 euros HT à 7 000 euros HT, pour une consommation en copeaux de bois et depuis l’an dernier en copeaux et plaquettes bocagères, qui oscille entre 50 et 60 tonnes à l’année.
Rien ne se fait sans subventions et sans volonté politique. À Saint-Usuge, patrie bressane de l’épagneul du même nom, le maire Didier Laurency s’est rendu compte que sur les 1 000 km² de sa commune, il ne pouvait rien faire contre les arrachages de haie. À part, comme l’a fait son collègue de Vendenesse-sur-Arroux, convaincre les agriculteurs de garder leurs haies en leur proposant une filière pour les résultats de leurs coupes. « On a commencé en 2014 avec la coopérative Bourgogne du sud, en créant un embryon de filière plaquettes. On a mis en relation un potentiel de production agricole avec les chaufferies locales existantes. Ça a marché ! » Pourtant, l’équation n’est pas simple même si ça en a l’air : un agriculteur, une haie, du bois, une chaudière. Tout peut avoir une influence sur le rendement énergétique final de la chaudière et les émissions de carbone nettes de la filière, depuis la coupe de la haie jusqu’à la combustion. « Le résultat pour nous à Saint-Usuge, pour chauffer l’école, la mairie, la bibliothèque, la salle polyvalente, la garderie, une cantine, en tout, 1 200 m² de planchers, c’est une chaudière [623 000 euros], couverte à 57 % par des subventions. » Le complément a été trouvé sur le marché des certificats d’économie d’énergie (CEE) : les industriels producteurs d’énergie sont en Europe [FD : oui, ça existe dans d’autres pays sous l’appellation white certificates/ directive D3E] tenus d’aider leurs clients à diminuer leur consommation, en leur achetant les économies qu’ils pourront faire dès lors qu’ils auront investi dans un nouvel équipement. Pour l’approvisionnement, la coopérative a trouvé des agriculteurs volontaires, a signé des plans bocagers avec la fédération des chasseurs et s’est engagée à prendre le bois de coupe des haies dans un rayon de 30 km autour du site de stockage des plaquettes. L’histoire s’écrit encore, car au printemps de l’an dernier, « on a fait une réunion avec des maires qui ont aussi des chaufferies, ceux qui les envisagent, ceux qui se posent des questions, l’idée était de leur proposer notre aide, une sorte de référence, et on va tenter maintenant de construire une sorte de comité d’utilisateurs des plaquettes, pour être, nous, élus, le pendant des producteurs, les coopératives et les agriculteurs. »
- Coût pour 200 « mètres cubes apparents plaquettes (MAP): »
- abattage : 5,5 heures à 135 € /h + 150 € de déplacement = 892,50 €
- déchiquetage : 2 heures à 480 €/ h + 100 € de déplacement = 1 060 €
- transport, mise en tas : 350 €
- stockage sous bâche perforée : 350 € (4 mois pour atteindre 20 % d’humidité
- total pour l’agriculteur : 2 660 € soit 13,30 € / MAP (ou 53,20 € / tonne).
Des fournisseurs d’énergie dans le bocage
En France, un des principaux acteurs de la médiation en matière d’environnement est le réseau des centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE). En Bourgogne, dans le Puisaye-Forterre, le CPIE Yonne et Nièvre fait justement se rencontrer les gens à propos du bocage. C’est le rôle de Florence Terrasse, chargée de la mission bocage, trognes et agroforesteries (au pluriel) : « on fait de la sensibilisation, mais aussi de l’accompagnement technique comme sur les PGDH, on accompagne la mise en place du Label Haie, on fait des visites conseils chez des agriculteurs, dans des mairies… » Inscrire ses richesses naturelles et sociales, dont le bocage, dans le développement du territoire. Pour cela, il faut de la « viabilité économique » pour la haie, sinon, les agriculteurs ne l’entretiennent plus, ou la coupent. Et afin de la trouver, le CPIE a créé avec la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, la Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz (SRPM), l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Epnak, le bureau d’études Pyxair, le chauffagiste La Technique Moderne et un agriculteur, Hugues Barrey une coopérative de fourniture d’énergie, la SCIC Charbonnette.
« La coopérative, c’est le meilleur modèle pour proposer des chaufferies clés en mains aux élus. Parce que tous les acteurs de la chaîne sont représentés, donc, on peut modéliser une filière plus facilement », de manière que la chaufferie fonctionne toujours à rendement élevé, explique Marc-Antoine Brice, le directeur de la coopérative. La collectivité n’a plus à se soucier des questions techniques, elle signe un contrat de fourniture de chaleur sur quinze ans, avec garantie d’un prix stable et des indices de révision. Pour une commune qui a subi l’explosion du prix du fioul ou du gaz avec la guerre en Ukraine, la promesse est attirante. La SCIC fait les études, réalise les travaux, exploite le réseau de chaleur collectif, s’occupe de l’approvisionnement en plaquettes, de l’entretien et de la maintenance. C’est aussi elle qui porte le financement, et s’occupe de trouver aides et subventions – Ademe, Région, département, Europe, banques. Pour le client, c’est transparent, il n’achète que du kilowattheure. « Tout le monde a intérêt à ce que ça marche, vu que tout le monde fait partie de la Scic et participe aux décisions, y compris les clients. » Pour l’instant, trois projets sont en cours de réalisation : le centre aquatique de Toucy, l’Ehpad Saint-Sauveur-en-Puisaye et des bâtiments collectifs à Bléneau.

Le paillage, l’autre avenir de la haie
Autre filière, le paillage, démontre Francis Terrier, chargé de l’approvisionnement en plaquettes des 22 magasins Gamm’Vert, une filiale de la coopérative Bourgogne du sud. Le paillage est donc un marché potentiel pour la haie. « On achète son bois à l’éleveur pour environ 39 euros la tonne sèche. On s’occupe du déchiquetage et du séchage. » Six cents tonnes de plaquettes sont ainsi produites par la coopérative, dont seulement 20 tonnes partent en sacs et en big bags chez Gamm’Vert. « Vous savez, notre but n’est pas de gagner de l’argent mais de préserver le paysage… » Quand bien même, paysagistes et particuliers achètent, le paillage se vend chaque année un peu plus, « au détriment du film plastique et de l’écorce de pin. Il a fallu convaincre nos clients, c’est l’argument de la production et bocagère, et locale, qui a fonctionné. » Autre motif de satisfaction, Francis Terrier voit de plus en plus d’agriculteurs qui replantent ici et là, « lorsqu’ils se rendent compte que leurs parcelles sont devenues séchantes. » Les haies retiennent les sols et l’eau, elles font de l’ombre et de la couverture. Ce n’est cependant pas suffisant, « il faudrait des formations pour tout le monde, les agriculteurs en particulier, pour valoriser les bienfaits de la haie et apprendre les bonnes techniques de taille », qui ont vraiment l’air de laisser à désirer.
Un autre paillage à développer est celui en litière de stabulation. La plaquette prend plus de place que la paille, elle est plus fraîche, ce qui peut rebuter des vaches, toutefois elle draine mieux les bouses et l’urine et favorise moins le développement d’agents pathogènes. Pour un élevage d’une centaine de têtes, il faut 200 tonnes de pailles, ou bien la moitié avec 300 m3 de plaquettes en sous-couche ou alors 800 m3 en remplacement total. C’est-à-dire entre 100 et 300 m de haies. Y aura-t-il un jour concurrence pour ce gisement ? On en n’est pas encore là, tant la haie peine toujours à justifier son existence.

Quelle valeur a la haie ?
Une justification purement économique. Aider la haie, c’est financer l’agriculteur. Sans subventions en amont, sans filières rémunératrices en aval, il est difficile de convaincre. La haie n’est plus un souci si elle n’est pas un coût trop lourd. Mais que vaut-elle alors si elle ne coûte pas un peu ? Dans une société de marché, la valeur est indiquée par le prix affiché. L’argent est un langage. Si un agriculteur n’a que quelques centaines d’euros à débourser pour planter 4 km de haies, en prendra-t-il soin autant que s’il avait dépensé quelques milliers ? La question mérite d’être posée (en off par des participants à cette journée) alors que le Sénat a raboté [FD : a priori oui, les crédits passent de 100 à 30 millions d’euros] . Le marché carbone pourrait-il compenser ? « Non, pour un industriel qui veut compenser, le prix de vente du carbone issu de bocages est trop élevé, de l’ordre de 140 à 180 euros la tonne [nous avons trouvé une fourchette de 80 à 160 euros], alors qu’il est de 60 euros pour la forêt », indique Pierre-Henri Petit. La haie n’est pour l’instant pas très intéressante pour la finance carbone. Elle ne l’est que si… elle n’existe pas : le consentement à payer de l’industriel est d’autant plus important qu’il sait que son investissement va lui permettre d’absorber virtuellement beaucoup du carbone qu’il a émis, il a donc intérêt à privilégier la plantation de haies sur un terrain où il n’y en a aucune, de façon que le stock de carbone soit maximal. On appelle cela l’additionnalité, minimale pour une haie déjà là et bien entretenue.

Et pourquoi pas le tourisme ?
Lors d’ateliers, la centaine de participants à la journée a pu dire ce qu’elle pensait des haies. À la question « pourquoi et comment privilégier l’approvisionnement local en plants et plaquettes dans les marchés publics », ils ont mis en relief de nombreux freins tels que le coût de la certification Label Haie et la difficulté à évaluer le linéaire disponible pour alimenter à l’année une chaufferie. Pour pallier cette seconde difficulté, il s’agirait de se réunir un peu plus souvent entre collectivités, acteurs de la filière bois et agriculteurs, avec lesquels il serait sans doute judicieux de signer des contrats pluriannuels attachés à l’exploitation. Ainsi, l’approvisionnement survivrait à un éventuel changement de fermier ou de propriétaire.
Autre question, « comment mieux organiser la production de plants ? » D’abord, en rendant visible la demande auprès des pépiniéristes afin qu’ils puissent anticiper achats et commandes. Ce qui implique a minima de mieux dialoguer avec les communes et les maîtres d’œuvre, de regrouper pourquoi pas les commandes pour des projets différents. Aux pépiniéristes de se regrouper afin d’y mieux répondre…
Troisième question, « quels moyens mettre en œuvre pour inciter à une gestion durable des haies ? » Ne pas chercher à tout prix à en mettre une sur la haie : son intérêt économique reste modeste pour les paysans. Et puis, les plans de gestion sont complexes à mettre en œuvre, et il manque des interlocuteurs compétents pour ce faire. Comme il manque de formateurs pour… former les agriculteurs, les élus, et tous les acteurs du bois ou de l’énergie, même si des financements ont été fléchés par les DRAAF dans le cadre du Pacte en faveur de la haie. Il manque surtout des techniciens “labellisés” pour délivrer le Label Haie. En fait, les gens se parlent peu, et se parlent mal, faute de mots à la définition commune, d’un échange réel des savoirs et de discours adaptés. Adaptés à qui on parle et à la réalité du sujet : la haie étant un bois, les forestiers ont sans doute plein de choses intéressantes à dire sur sa gestion, son entretien, sa coupe. Comme tant d’autres sujets dans notre pays qui méconnaît le dialogue, la haie est décidément bien lourde à porter parce qu’elle est difficile à dire.
Enfin, « y a-t-il d’autres débouchés que l’énergie et le paillage ? » Pour répondre à cette dernière question, les participants ont beaucoup insisté sur la difficulté d’évaluer quoi planter, avec quelle diversité, quel écartement entre les plants, quelle largeur de haie, sur combien de rangs et avec quelles interactions avec les cultures. Mitigés sur le paillage en stabulation, ils le sont moins sur une filière peu développée, celle du bois-bûche. Après tout, il y a dans les haies des arbres d’âge suffisant pour être débités de la sorte. Il y a aussi des essences et des tailles qui permettent de faire du bois d’œuvre et du piquet de clôture. Il y a enfin des feuillages qui peuvent constituer un excellent fourrage pour le bétail. Mais, toujours la même interrogation, avec quel retour économique ? Sans massification de chaque filière, il n’y aura pas d’amortissement possible, et l’agriculteur se détournera de la haie. La justification économique touche en fait à ses limites. Pourquoi après tout la haie devait-elle valoir quelque chose ? Vaste débat, dans un pays où seul le patrimoine culturel à une valeur intrinsèque. Le moindre vestige du passé est classé, respecté, subventionné sans que personne ne s’offusque. Pourquoi pas la haie, alors que les paysages constitutifs des identités territoriales peuvent être classés ? D’ailleurs, des participants ont évoqué l’idée de valoriser la haie en tant qu’élément majeur de paysages touristiques. Alors, pourraient-elles se voir destiner un pourcentage des taxes de séjour prélevées sur les nuitées des touristes. Mais que vaudrait alors une haie qui n’attirerait pas de touristes ? Aussi peu qu’une espèce non classée ?

SOcialiser la haie ?
« On tourne en rond dans le bocage. Ce qui était un atelier dans des exploitations autonomes est devenu un bien public dans des fermes dépendantes. Au cours du XIXe siècle la haie a été le vecteur d’un réaménagement des territoires agricoles dans une économie rurale largement fondée sur la nature. Aujourd’hui, la société hors-sol demande à une minorité de ses citoyens, les agriculteurs, de l’entretenir parce qu’elle lui offre beaucoup de services, alors qu’elle ne leur en procure pas de manière évidente et leur coûte selon le modèle économique et culturel dont ils ont hérité. La haie est à la fois un fossile et un fétiche. Agriculteur ou urbain, chacun y projette ses fantasmes : la haie d’aujourd’hui est une réécriture du passé. Comme les prairies et les bosquets, les rivières non canalisées et les zones humides, les haies sont certes des écosystèmes bien vivants qui limitent pour nous les risques d’inondation, de sécheresse, d’érosion des sols, de pollution et d’emballement climatique. Mais voilà, ces écosystèmes d’une grande complexité se trouvent pour l’essentiel sur des parcelles agricoles. Privées. Dévolues à un but, la production de nourriture dans un marché où les agriculteurs ne fixent pas leurs prix de vente. De par leur importance écologique, les haies sont de fait des biens publics, peut-être des biens communs, dont nous exigeons le bon entretien aux agriculteurs sans leur donner vraiment les moyens de le faire, ni même de vivre au regard du temps qu’ils passent à nous nourrir. Ils sont victimes du plus grand plan social de l’histoire, ils se sentent largement déconsidérés, tout de même on les plaint une fois par an à l’occasion du Salon international de l’agriculture, et il faudrait qu’ils plantent et entretiennent nos haies, pour notre plaisir de promeneur ou de simple contemplateur d’une nature résumée à des clichés à la télé ! Des haies qu’ils devraient planter et entretenir en respectant une dizaine de textes réglementaires complexes et à l’issue de multiples processus d’aides publiques. Si la haie est aussi importante, pourquoi la société décourage-t-elle sa multiplication par cette absence de simplicité ? D’ailleurs, pourquoi l’État a-t-il réduit le budget de son pacte en faveur de la haie ? Les temps sont durs, mais le message est contradictoire : dans une enquête BVA parue en mai 2024, les agriculteurs interrogés à propos de la pause du plan EcoPhyto déclarent que c’est une « non décision » qui crée encore plus d’incertitude… un « retour en arrière » qui rend inutiles les investissements déjà réalisés par certains pour s’y conformer… et une « incohérence dans le message véhiculé » : si le sujet était considéré comme important, pourquoi reculer ? On peut se poser la même question à propos du Pacte en faveur de la haie. 110 millions d’euros, puis 30. Des haies dont les atteintes ont été largement dépénalisées par la loi d’orientation agricole. La haie c’est donc important… mais en réalité, ça ne l’est pas tant que ça. Alors, pourquoi s’embêter à en planter ?
Oui nous tournons en rond dans le bocage. Nous nous agitons pour recoller des pansements sur une infrastructure qui n’est pas vraiment reconnue et dont le contexte de l’altération n’est pas contredit. Et si nous assumions ? À voir la complexité à monter des dossiers de financement pour planter cent malheureux mètres de haie, à considérer l’impasse de justifier l’existence d’un bocage à l’aune de ce qu’il pourrait rapporter en kilowattheures demain – ce qui rend impossible de planter une haie sur une parcelle trop loin d’une chaufferie-bois, on peut se demander si d’une manière ou d’une autre il ne faudrait pas sortir les haies de leur appartenance agricole, les socialiser pour en faire des éléments d’urbanisme à la charge des collectivités, c’est-à-dire, des contribuables. Pourquoi ne pas les considérer comme la voirie ou les rivières ? Allons plus loin, les haies ne sont-elles pas aussi, avant tout ?, des biens culturels, constitutifs de notre patrimoine immatériel, car en modelant nos paysages au fil du temps, les agriculteurs ont créé ici et là des œuvres au même titre que les architectes de notre patrimoine historique, intouchable autant que dispendieux. Un bocage bourguignon vaut-il moins qu’une des innombrables églises romanes de la région ? Voilà des réalisations qui sont autant des œuvres de la main que de l’esprit, qui pourraient générer des sortes de droits d’auteur à redistribuer vers celles et ceux qui les entretiennent. Le risque étant de figer ce patrimoine naturel-culturel, de l’empêcher d’évoluer, comme on muséifie les secteurs sauvegardés des villes et certains espaces naturels protégés Puisqu’on demande tout aux agriculteurs, accordons-leur d’être aussi des forestiers, des architectes et des créateurs. Et d’être payés pour cela.

Ce texte a été publié sous une autre forme par l’Ademe :
