Les eaux de pluie ne sont plus gênantes. Longtemps furent-elles considérées à l’égale de déchets, à ôter des regards, sous les pieds, dans des tuyaux, à l’extérieur des villes. La cité devait revêtir un aspect contrôlé. Elle était régentée par le génie civil qui face à un volume de pluie répondait par une section de tuyaux. Et si d’aventure l’eau débordait quand même, à l’occasion d’un orage à l’intensité originale, si elle occasionnait beaucoup de dégâts, la ville demandait aux ingénieurs de lui usiner des canalisations plus grosses, des déversoirs plus profonds, des bords de rivière plus lisses. Comme dans un spectacle de fin d’année perturbé par un spectateur qui se précipite tout nu sur la scène, quand l’eau de pluie s’échappait de son corset, il fallait l’évacuer fermement et discrètement. Tout cela est peut-être terminé. Depuis quelques années, l’eau de pluie n’est plus considérée comme un déchet, elle est une ressource pour faire de l’ombre en hiver et même, pour réaménager la ville. La pluie est devenue un acteur social, grâce notamment au travail conduit par Idealco qui depuis près de dix ans organise le forum national de gestion des eaux pluviales. La dernière édition a eu lieu dans les salons du stade Bollaert-Delelis à Lens.
Photos © FD, vidéos © Idealco

Le modèle Adopta
Rien d’étrange à ce que ces deux journées d’ateliers et de plénière se soient déroulées en pays ch’ti dans la mesure où les eaux pluviales sont entrées en révolution près d’ici, à Douai. Entre 1992 et 1998, la ville du joli musée de la Chartreuse s’était retrouvée, cinq années de suite, débordée par des orages majeurs qui avaient fait se répandre la Scarpe, l’une des grandes rivières du Nord. Les élus s’étaient rendu compte que les systèmes d’assainissement n’étaient pas parvenus à gérer les flots, qu’il allait en conséquence falloir faire un choix : ou bien changer les tuyaux pour des plus gros, très chers, ou bien s’occuper des pluies avant qu’elles ne parviennent jusqu’aux mêmes tuyaux. Le système traditionnel avait atteint ses limites, il débordait de partout et menaçait les finances publiques. Encore fallait-il oser le transformer.
Créée pour trouver des solutions, l’association Adopta (association pour le développement de techniques alternatives) s’est révélée être un modèle de concertation entre usagers et acteurs de l’eau, et d’inventivité technique. C’est avec elle que l’agglomération de Douai arrêta le fait que tout aménagement à venir sera sans connexion physique avec le réseau d’eau pluviale. Il fut décidé de ne plus rejeter dans le système de tuyaux habituel, de laisser la pluie s’infiltrer là où elle tombe, à l’air libre, en se rapprochant le plus possible du cycle naturel de l’eau. Créée pour accompagner ce changement de paradigme, comme on dit sur les plateaux télé, Adopta était censée servir de modèle pour les associations du même type, pour chaque collectivité de l’alors région Nord-Pas-de-Calais. Ici et là, les Adopta auraient conseillé bureaux d’études, maîtres d’œuvre, géomètres, paysagistes, entreprises du BTP, pour comprendre et mettre en musique l’infiltration dite à la parcelle, la déconnexion des réseaux, le retour de l’eau dans la ville. En réalité, tout le monde est venu vers l’association qui, une génération plus tard, est quasiment seule sur le territoire ch’ti.
Un modèle. Plus de 2 000 réalisations en vingt ans, présentées dans un showroom à Douai et un parcours pédagogique à Clairoix, dans l’Oise. Allez-y si vous voulez savoir comment installer une toiture végétalisée sur votre projet de gymnase, une chaussée réservoir à la place du vieux boulevard, des dalles de gazon sur la place, une tranchée d’infiltration au milieu de l’avenue.
Du bon sens vulgarisé sans cesse par l’association : voulez-vous construire un parking ? Bordez-le d’une bande enherbée de façon que l’eau s’y imprègne. Vous allez bâtir un immeuble, vous aurez un parc tout autour ? Dérivez-y les gouttières afin qu’elles l’abreuvent. Aujourd’hui, à Douai, le boulevard Bréguet, pendu entre la Scarpe et son canal de dérivation au nord de la ville, est séparé en deux tronçons par une large bande enherbée qui récupère les eaux de pluie. 25 % environ de la surface de la ville sont gérées de cette manière. En 2005, Douai a connu un orage centennal, il n’y a pas eu d’inondations. Ailleurs, à Oignies, dans le bassin minier, la cité Bonnier a été modifiée de façon que les eaux de pluie, « tamponnées » par des trottoirs de terre, des noues épaisses, des massifs plantés dans les jardins et les espaces verts, puissent être rejetées directement dans le milieu naturel. Cela a coûté 1 170 euros TTC par mètre linéaire de voirie, 11 165 euros TTC par logement. Plus au nord, sur la partie est du port de Dunkerque, des massifs d’infiltration, tout herbus, ont été installés à la place des joints séparant les grands pavés de porphyre. Les pluies habituelles attrapent la pollution formidable des toitures et des pavés du port, passent au travers des massifs, traversent en une journée du sable et des graviers avant d’être drainées en profondeur par des petits tuyaux qui les amènent, en grande partie épurées, vers le réseau traditionnel. Marier sol ajouré et tuyaux pour faire face à la pollution : les solutions fondées (SfN) sur la nature ne sont pas antinomiques avec le bon vieux génie civil pour gérer différemment les eaux pluviales.
Le couperet de la DERU 2
L’expérience douaiso-adoptienne a marqué. En référence ou pas, l’État en a inscrit la philosophie dans le droit : les arrêtés du 21 juillet 2015 et du 31 juillet 2020 demandent aux villes de faire en sorte que « les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte » ou bien qu’ils soient à l’origine de moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné » ou, autre option, « que moins de 20 jours de déversement soient constatés au niveau de chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance réglementaire. » En clair, la loi impose de ne pas verser l’eau de pluie dans le réseau d’assainissement plus de 20 fois dans l’année, ou bien que ces vidages restent inférieurs à 5 % des volumes habituels d’eaux usées. Les villes doivent choisir et trouver des solutions de stockage ou de tamponnage. Par du béton pour stocker le trop-plein, avec la nature pour le limiter et le ralentir. Comme le rappelle Philippe Gouteyron, directeur de projet Plan Eau au ministère de l’écologie, ce seuil de 5 % va être très abaissé avec la DERU (directive eaux résiduaires urbaines) version 2 : « ce sera 2 % ! Et on a jusqu’à fin juillet 2027 pour traduire cette nouvelle directive européenne en droit français. Elle sera un aiguillon, une boussole, qui va nous inciter à trouver de nouveaux leviers pour agir sur les eaux pluviales. Il va falloir trouver des solutions qui facilitent la limitation des rejets par temps de pluie, et donc, réduire au maximum les déversements. Les collectivités devront développer une vraie stratégie, une vision d’ensemble. » Déjà, ne plus considérer que les bassins d’orage sont la destination de la moindre pluie. « La priorité est et sera d’infiltrer le plus en amont possible, en particulier dans les agglomérations où le réseau unitaire existe toujours : il faut réduire à tout prix le déversement et le dimensionner uniquement en rapport avec les orages. » Aux SfN les pluies habituelles, aux bassins d’orage tout ce qui dépasse.
Encore faut-il bien calibrer. Eu égard à l’augmentation de l’imprévisibilité des précipitations par l’effet du changement climatique, qui s’accélère, qui s’aggrave nous dit le programme européen Copernicus dans sa dernière livraison du 15 avril 2025, les collectivités ont avant toute décision intérêt à développer zonages pluviaux ou schémas directeurs de gestion des eaux pluviales (SDGEP). Des préalables. Les premiers datent d’une loi de 2010, ils sont obligatoires et adossés aux PLU (i). À partir des équipements d’assainissements et pluviaux existants, ils sont censés permettre de gérer le ruissellement et de prévenir la dégradation des milieux aquatiques lors des grosses pluies. Située entre Valenciennes, Douai et la Belgique, sur l’axe Denain-Saint-Amand-les-Eaux, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut a le sien, avec dedans une cartographie du potentiel de « déraccordement » (sic). Aller plus loin, pour apprécier l’adéquation du réseau d’eau pluviale aux évolutions prévisibles de la démographie urbaine et des précipitations réclame la réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Mis en place en 2015, ce document est facultatif et non opposable, à moins qu’un SAGE ne décide d’en faire une obligation.

Les eaux pluviales ne sont pas financées
Des outils réglementaires veillent donc à la bonne gestion de l’eau tombant du ciel. Il fallait quand même voir s’ils fonctionnaient convenablement. En 2017, l’État commanda donc une enquête à Pierre-Alain Roche, membre du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). « On a pu prendre une bonne année pour faire un travail plus approfondi que d’habitude alors que les calendriers sont d’ordinaire toujours trop réduits. On s’était donné l’échéance de 2027 pour nos objectifs, cela faisait dix ans. » 10 ans pour agir, un laps de temps nécessaire, conforme au temps de la décision publique. « Il y avait urgence à travailler sur la question des eaux pluviales, car si on prend l’entrée protection des milieux aquatiques et de la biodiversité, il était clair qu’au fur et à mesure de la dépollution des eaux, les rejets d’eaux pluviales prenaient une part prépondérante dans la pollution des eaux rejetées. Il y avait en 2017 le sentiment qu’on était pris en cisaille entre des objectifs ambitieux et pas réalistes – comme la dépollution totale par tous les temps, ce qui aurait supposé des investissements impossibles à réaliser, et un sentiment d’inadaptation aux risques liés aux eaux débordantes. » Il y avait aussi un souci de financement, bien surligné dans le rapport.
Sans base légale irréfutable, la gestion des eaux pluviales urbaines était – elle l’est encore – confondue avec le service public de l’assainissement, financé par l’usager du service public, à hauteur, à l’époque, de quelque 2 milliards d’euros. Ce serait 2,5 milliards aujourd’hui, soit plus que le budget de toutes les agences de l’eau. Dans son rapport, remis en décembre 2016 au ministère de l’écologie, publié seulement une bonne année plus tard après un délai de réflexion qui a fait sourciller, Pierre-Alain Roche recommandait d’établir une compétence particulière eaux pluviale pour certaines collectivités (les EPCI), comprenant le ruissellement. Aussi, de « fusionner le service public de gestion des eaux pluviales urbaines et celui de l’assainissement collectif en l’étendant au ruissellement, avec des dispositions financières adaptées. Il s’agit d’abonder le budget annexe d’assainissement ainsi élargi, par une combinaison de compensations de charges de service public issue du budget général des collectivités pour les voiries et espaces publics, et par des redevances d’usage du service perçues sur les constructions et leurs annexes. » Pierre-Alain Roche proposait non seulement de réunir administrativement les eaux dans une compétence unique eaux usées-eaux de ruissellement-eaux pluviales-Gémapi (inondation) avec schéma directeur unique, mais aussi de financer leur gestion par de nouvelles taxes perçues sur les constructions et tout ce qui imperméabilise les sols, et non plus seulement à partir des redevances perçues sur les factures des usagers.
Pierre-Alain Roche fondait sa demande sur l’échec de la taxe pour la gestion des eaux pluviales, mise en place par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, modifiée par la loi Grenelle 2 de juillet 2010, finalement supprimée par la loi de finances de 2015. Elle était de 1 €/m2/an au maximum. « Le désagrément de voir les budgets de voirie amputés pour alimenter les budgets d’assainissement a pesé lourd dans le désintérêt de beaucoup d’élus pour cette mesure. Seuls ceux qui étaient en charge des syndicats d’assainissement, potentiellement bénéficiaires de la taxe, la soutenaient véritablement », peut-on lire dans le rapport. Autre raison avancée par M. Roche, la taxe, « dans ses dernières étapes, concernait autant les collectivités locales elles-mêmes, au titre de l’imperméabilisation des espaces publics et voiries que les propriétés privées. » Elle n’était pas populaire, peu d’élus s’en sont saisis. Président d’Adopta, Jean-Jacques Hérin la regrette avec amertume : « Sur Douai, c’était 5 c le m2, c’était faible, mais cela avait l’immense avantage de mettre en lumière le fait que déverser ses eaux pluviales – privées – vers le service public avait un prix. Or, dans notre société, ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur… » Président du comité de bassin Artois-Picardie, grande figure régionale de l’eau, André Flajolet acquiesce avec un dépit semblable : « que voulez-vous, la France est ce pays merveilleux qui a toujours pensé que l’eau devait être gratuite alors qu’elle a un coût ! » Jean-Jacques Hérin poursuit : « le tort que cette taxe a eu était de s’appeler… taxe. Pourtant, elle a incité les élus à une gestion différente. D’ailleurs depuis qu’elle n’existe plus il y a eu des reculs. »
Le rapport Roche a-t-il été lu ?
Les eaux pluviales ne sont toujours pas financées. Sont-elles vraiment considérées ? Il semblerait que la lecture du rapport ait décidément pris un peu de temps, car aucune des autres propositions n’a été sérieusement mise en œuvre par le législateur. Dans le Plan d’action eaux pluviales rendu public par le ministère de l’écologie en novembre 2021, trois ans après la diffusion publique du travail de M. Roche, on en restait encore aux constats lénifiants et on déployait pour y répondre des « actions phares » qui encourageaient, incitaient, facilitaient, sensibilisaient, formaient, développaient. Ça ne mange pas de pain. On se rassurait un peu en lisant page 17 « [qu’] un travail sur l’articulation entre les compétences GEPU [Gestion des eaux pluviales urbaines], GEMAPI et assainissement est prévu au cours de la période 2022-2024. » C’est bien, de prévoir. Les choses semblent bien avancer avec la hâte d’un ruisseau sous canicule. Pierre-Alain Roche a l’art de la litote : « quand on raisonne sur le changement climatique, il ne faut pas oublier que la construction des villes a ignoré les risques, on a donc un exercice de rattrapage, sans doute plus facile à concevoir lors de la conception d’un quartier nouveau comme Matra à Romorantin [un quartier inondable, et inondé sans dommages, conçu en 2015], encore trop rare. Il s’agit de penser la ville, en n’oubliant pas la nécessité de maîtriser les eaux débordantes. Retravailler le bâti, les voiries, les espaces verts existants, pour faire en sorte d’éviter les obstacles et les embâcles. » L’eau passe sur la ville, elle s’écoule à travers elle, la ville doit la laisser s’écouler lorsqu’elle déborde, faire en sorte que le parking souterrain ne se transforme pas en piscine enterrée ou les automobilistes se noient. M. Roche donne l’exemple de Cannes et de Figueras en Espagne, qui ont su s’adapter à l’inéluctable, des pluies fortes et des inondations plus fréquentes : « les aménagements y tiennent compte du fait que l’eau doit circuler, avec par exemple des trottoirs hauts ; en 24 heures les services de la ville sont capables de tout remettre en état… oui ça a progressé, mais il manque encore des réformes institutionnelles, » celles qu’il avait estimées indispensables en 2017. « Il faudrait au moins que l’État ait un deal avec les collectivités, avec une contractualisation d’objectifs, là non plus ça n’a pas beaucoup avancé, » demande M. Roche.
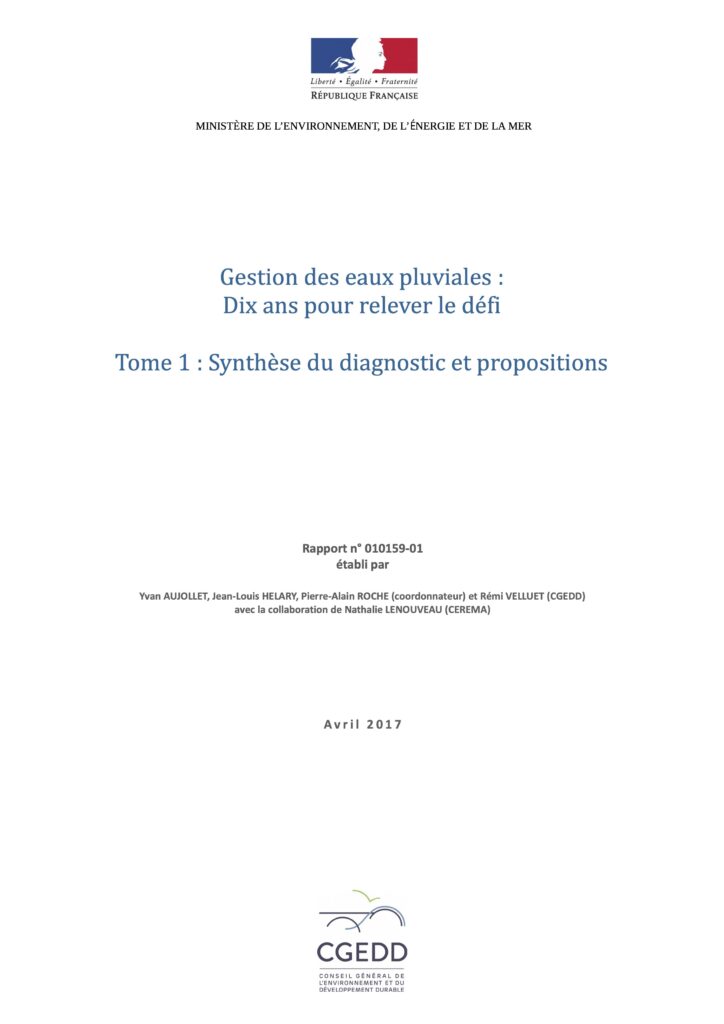
Philippe Gouteyron voit le verre à moitié plein, il défend son employeur : « depuis décembre 2024, un décret renforce la prise en compte du Sage et de son contenu dans les documents d’urbanisme, » ce qui pourrait augmenter mécaniquement le nombre de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales. « Les SDAGE et les SAGE, c’est la bonne échelle, c’est là où les choses se passent, » les seuls documents de planification qui permettent d’avoir un effet de levier. Dans le SDAGE du bassin Artois-Picardie que présente Hervé Canler, chargé d’études sur les eaux pluviales à l’agence de l’eau Artois-Picardie, on lit en effet que « les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU comprennent des dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux de pluie à l’emprise du projet, » que « la conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de valorisation de l’eau sur le territoire, » ou encore que « chaque projet ou renouvellement urbain doit être élaboré en privilégiant les solutions fondées sur la nature. » Chargée d’animation du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer, au nord-est de Paris, Aline Girard indique que chez elle, les règlements d’assainissement et les zonages pluviaux, opposables dans les PLU et PLUi, ont été revus afin d’y inscrire les principes du SAGE, de la manière suivante : « L’infiltration et l’évaporation sur la parcelle doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur la parcelle (…) ainsi, pour les 8 premiers mm de chaque épisode pluvieux, le rejet 0 est considéré comme le cas général. » Pour accompagner les collectivités, un poste d’animateur eaux pluviales et désimperméabilisation a été créé, et un « référentiel des paysages de l’eau » a été élaboré.
Tout repose sur l’échelon local, autrement dit, sur les bonnes volontés.

Il faudrait déjà savoir ce qu’est… une eau pluviale
La frontière entre gestion du risque inondation, gestion des eaux pluviales, assainissement et ruissellement demeure très floue, d’autant que le cycle de l’eau se partage toujours entre une multitude de services au sein des collectivités. Le PPRi ne tient toujours pas compte de l’eau qui s’écoule sur la ville. Il faudrait une « approche décloisonnée », défend Sébastien Dupray, directeur technique Risques, eaux et mer au Cerema. Chacun est dans son couloir de nage, la France pense en silo, et les silos sont nombreux, tout le monde le déplore, tous réclament des interfaces où ils pourraient dialoguer. L’eau est séparée en ses multiples états, et en autant de services qu’il en existe dans les collectivités. Rares sont les agglomérations telle que Montpellier qui ont créé un poste d’ingénieur désimperméabilisation et urbanisme, ou Poitiers une vice-présidence dédiée au pluvial.
Peut-être est-ce une explication, les eaux pluviales sont mal connues. En France, on passe sa vie à se réunir, à faire table ronde ou atelier, sans se demander si les participants savent de quoi ils parlent. Il manque une culture commune, un vocabulaire partagé. Conjointement, la CDC habitat et la Semac, Société d’Économie Mixte d’Aménagement et de Construction de l’île de la Réunion ont constaté la chose de manière abrupte : « Faute de règles et de normes, on trouve nombre de guides produits par des collectivités ou des associations, proposant chacun leur propre définition de la GIEP [gestion intégrée des eaux pluviales], générant parfois de la confusion à la fois sur la définition du besoin et sur l’atteinte des objectifs. La GIEP, c’est un environnement professionnel propice à la confusion et au greenwashing. » Pan ! Durant un atelier, Pierre Kolditz, chargé de mission cycle de l’eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a appelé chacun à s’entendre avec l’autre sur une définition commune de la gestion des eaux pluviales… « C’est la partie de l’écoulement qui est gérée par des dispositifs dédiés (infiltration, stockage, collecte, transport, traitement éventuel) ; elles [les eaux pluviales] interagissent en permanence avec les eaux souterraines et les autres réseaux, » et une autre, qui en découle, le ruissellement (« la partie de l’écoulement qui n’est pas gérée par des dispositifs dédiés, » c’est tout simple). Deux définitions tout bêtement extraites du rapport… de Pierre-Alain Roche. Une fois bien en tête, on peut lire le Guide de bonne gestion des écoulements pluviaux et de ruissellement qu’a concocté la FNCCR pour les élus. « Agir en cohérence avec les autres acteurs ; articuler la gestion des eaux pluviales avec les autres politiques publiques ; comprendre quelles sont les responsabilités juridiques respectives de chacun ; mobiliser et mettre en place des mécanismes financiers partenariaux ; prendre appui sur les outils de coopération public-public et public-privé, » en voici quelques canons.
Le manque de connaissances et de concertation nourrit la confusion qui crée des blocages. Directeur du développement et de la maîtrise d’ouvrage à la Semac, François Outin parle de mauvaises habitudes et de croyances malheureuses : « Culturellement [à la Réunion], l’eau ne se stocke pas, elle se canalise, elle fait peur, elle est un « ennemi » des biens et des personnes que le maître d’œuvre doit s’empresser d’évacuer de l’assiette foncière du projet, » décrivait-il dans un autre atelier, tout en désignant la méconnaissance générale de la gestion des eaux pluviales à toutes les échelles administratives. Cette inculture génère bien des a priori, en particulier sur l’île de la Réunion : « on entend que la GIEP ne fonctionne pas quand il y a de la pente ; sous les tropiques et ses épisodes pluvieux intenses ; dans toutes les natures de sol ; [qu’elle] n’est pas autorisée par tel texte ou telle norme ; [qu’elle] n’est pas compatible avec les règles sanitaires relatives aux moustiques ; [qu’elle] nécessite d’augmenter la surface des bassins et n’assure pas la pérennité des ouvrages, etc. » Avec la société Elleny et l’association Qualitel, la Semac a créé un label GIEP pour rassurer les porteurs de projet. L’école des Ponts et chaussées propose une autre certification, le « Global Aqua Building. » Quant à elle, l’association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (Astee) a développé un cadre de bonnes pratiques, sous la forme d’une « Charte de qualité nationale des ouvrages et aménagements de gestion durable et intégrée des eaux pluviales. » Le principe ? C’est la société Elleny qui le présente : une bonne gestion des eaux pluviales, c’est gérer l’eau au plus près du lieu où elle précipite, ne pas la mettre en mouvement en la faisant transiter d’ouvrage en ouvrage, rechercher un stockage le plus superficiel possible, définir des temps de vidange selon les usages des zones de stockage, prioriser l’infiltration de l’eau dans les espaces verts, et réaliser des ouvrages simples et pérennes. Dis comme cela, ça a l’air simple.
Le ruissellement et les sols, ces grands oubliés
André Flajolet s’interroge. « Il s’agirait de constater enfin que les eaux usées, il ne faudrait plus y mettre les eaux pluviales, ce qui aujourd’hui oblige à créer des cathédrales souterraines pour les stocker. Qu’elle passe dans les réseaux ou qu’elle glisse le long des fossés, l’eau pluviale va à un moment donné à la station d’épuration, qui se retrouve en surcharge, ou à la mer, » on fait donc du génie civil pour bâtir des réservoirs gigantesques afin de ne pas noyer les stations d’épuration. Mieux vaudrait que l’eau de pluie soit infiltrée aussitôt qu’elle commence à ruisseler, « à la parcelle ». Créer en quelque sorte des mini-zones d’expansion de crue avant la crue. Certes, cela fait longtemps qu’on le dit, mais, que voulez-vous, « on n’est pas équipés en bureau d’études compétents, ni en ingénierie politique, on manque de techniciens et d’élus capables de porter ce discours, car c’est un changement de vision des rapports entre l’homme et la nature, et un changement financier car cela suppose des aménagements urbains conséquents, et des aménagements ruraux qui vont à l’encontre de ce que subventionne la PAC. » Les bureaux d’études. Les témoignages d’élus sont nombreux sur leur incompétence ou leur opportunisme. Un parmi d’autres, recueilli par téléphone en Haute-Savoie par l’auteur de ces lignes : « ils jouent sur notre manque de temps et notre manque de compétences en la matière. Pourtant, faire des études sur les eaux pluviales, c’est un mélange d’hydrologie, de connaissance des sols et du réseau existant. C’est appliquer surtout des formules… sans aller sur le terrain, ce qui conduit à des recommandations aberrantes, sans rapport avec la réalité. » Qui plus est, « les eaux de ruissellement, celles qui circulent sur la voirie, ils n’en tiennent pas compte. Et nous, notre station d’épuration, quand il pleut beaucoup, elle consomme plus de réactifs… » Un coût approché de l’artificialisation des sols.
André Flajolet la dénonce. La terre a été domestiquée car il faut qu’elle produise, dit-il, et l’on paie les dommages collatéraux avec le ruissellement, « parent pauvre des réflexions sur l’eau. » Un autre parent pauvre, ce sont les sols : « ils n’absorbent plus, alors que le rapport de la terre à l’eau est devenu central. Comment puis-je utiliser intelligemment l’eau de ruissellement pour en faire une donnée de mon développement ? Comment faire en sorte que demain on ne soit plus en train d’évacuer l’eau de ruissellement mais de la récupérer, de la transformer, de l’utiliser, pour en faire une alliée du développement durable ? Déjà en se disant qu’on ne commande à la nature qu’en lui obéissant, ce qu’on est en train de redécouvrir. Est-ce que l’homme est capable de modifier son rapport à la nature, de modifier ses aménagements ruraux de manière que les types de productions soient en adéquation avec la saisonnalité et l’espace rural ? » André Flajolet critique autant l’espace urbain pensé uniquement pour l’évacuation rapide des eaux pluviales et l’espace agricole dévolu par « l’agrochimie » au « commerce international. » Conseillère technique à la FNCCR, Sandrine Potier ne dit pas le contraire : « on ne gère pas les eaux pluviales en autarcie, il faut voir plus largement, le ruissellement et les aires rurales. » Ne pas oublier non plus, comme le rappelle Sébastien Dupray, que 80% du foncier est privé en ville. L’infiltration à la parcelle, les noues végétalisées, les jardins d’eau, et autres « jardinières loi LOM » installées à Boulogne)-Billancourt (Hauts-de-Seine) ne peuvent donc capter qu’une petite partie des eaux pluviales et limiter un petit peu le ruissellement.
Tirer le fil des eaux pluviales déroule une sacrée pelote, celle de notre mode de vie, l’organisation de la société. « Il y a des choses qui bougent, c’est sûr, mais cela ne pas assez vite, car il faut remonter tout un schéma de… désorganisation sociétale pour modifier ne serait-ce que la base de la gestion de l’eau, et trouver des schémas agricoles plus adéquats. » Il faudrait des lieux de partage, d’échange et de propositions, par exemple pour que les différentes sensibilités agricoles aient un lieu d’expression. « Les EPTB, c’est pas mal. » Pourquoi pas les commissions locales de l’eau ? « Elles ne respirent pas toujours la démocratie, il y règne la force des habitudes. »
Un engagement politique impérieux
L’eau pourrait être un acteur du ménagement des territoires. L’eau pluviale en particulier. Cependant elle n’est pas tout à fait bien comprise par les collectivités. Elle n’est pas non plus toujours considérée en tant que facteur d’inondation : le PPRI, répétons-le, ne tient pas compte du ruissellement, à moins qu’on ne le modifie pour cela ou, comme l’a réalisé en 2018 la Métropole de Lille, que l’on élabore un plan spécifique, « le PPRI ruissellement pour le bassin-versant de la Lys à l’aval de la Deûle. » Un PPR peut être établi pour n’importe quel risque. Le Cerema est là pour aider. En faisant visiter son établissement de Saint-Quentin dans l’Aisne. « On a fait de notre site un démonstrateur, pour faire venir les élus, » présente Bruno Kerloc’h, Chef de groupe. « On a planté en phase 1 une haie et un bosquet, on a laissé en croissance libre une « petite forêt » de 270 m2. En phase 2, après une année d’études, on a végétalisé des toitures, créé une mare à niveau variable (elle se vide naturellement), désimperméabilisé le parking avec notamment une chaussée à structure réservoir sur la partie la plus basse. » Rendez-vous dans trois ans pour l’évaluation complète du projet, avec déjà un résultat : le ruissellement sur les toitures végétalisées a diminué de 71 %.
De quoi montrer à quelque 1 000 collectivités qu’elles n’ont pas adhéré pour rien au Cerema. Sébastien Dupray : « Elles nous disent qu’elles sont parfois démunies, elles nous interrogent à propos de la directive inondation ou de la cartographie des inondations. » Il y a 19 millions de citoyens en zone inondable, or, d’après M. Dupray, 50 % des dégâts ne sont pas liés au débordement d’un cours d’eau, mais à ceux des égouts, au ruissellement. C’est sans doute beaucoup plus à lire les travaux de l’Institut Paris Région (IPR). Dans une de ses « chroniques des crues et inondations en Île-de-France » de novembre 2023, Ludovic Faytre, géographe-urbaniste, référent études risques majeurs-aménagement de l’IPR met en exergue les chiffres suivants : 88 % des événements enregistrés depuis 1982 donnant lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle « inondation » en Île-de-France peuvent être rattachés à des phénomènes de ruissellement ; 100 % des communes franciliennes sont potentiellement exposées à l’aléa ruissellement, soit 101 400 ha (8,4 % du territoire régional).
« On essaie de donner des éléments d’informations pour faire prendre conscience, cela a énormément progressé, la question qui se pose maintenant c’est « comment faire ? », alors nous produisons des guides, des outils, pour passer à l’action, » présente Sébastien Dupray. Des solutions adaptées pour les petites pluies, les moyennes ou les plus intenses, en fonction de chaque territoire. « On essaie de faire comprendre aussi qu’il y aura toujours des éléments qu’on n’avait pas prévus, et que la réponse n’est pas qu’une question de tuyaux. » Comment faire mieux ? « Collecter les bonnes solutions, les capitaliser, et les partager. » Le Cerema est un centre de ressources. « Les solutions sont toujours une forme de compromis entre ce qu’on sait faire, ce qu’on peut s’offrir en termes d’argent public, le coût de l’inaction et ce qui est acceptable. Elles apportent toujours plein de services par euro investi. » Ce dont sont certains les gestionnaires de l’habitat social. En conclusion des journées de Bollaert, l’Union régionale de l’habitat, l’agence de l’eau Artois-Picardie et la Banque des territoires ont signé une convention qui les engage à soutenir la gestion des eaux pluviales à la parcelle dans tout projet de construction de ou de rénovation de logements. Trois autres conventions semblables avaient déjà été signées par d’autres agences de l’eau. Un peu avant la signature de celle-ci, Maya Cazin Directrice générale adjointe d’Épinal habitat avait donné le sourire à tout le monde. Elle rapportait les résultats de l’étude du potentiel de déconnexion de 5 000 logements sociaux répartis entre 300 bâtiments : « 60 % des sites sont caractérisés par un potentiel de déconnexion facile à très facile ! » Y a plus qu’à, comme l’a fait la quarantaine des techniciens qui durant deux jours ont présenté leurs chantiers ou leurs réalisations. Gérer différemment les eaux pluviales, c’est possible et cela donne des résultats immédiats. À la condition d’un engagement politique impérieux, ont dit la plupart.

